|
Dominique Potier |
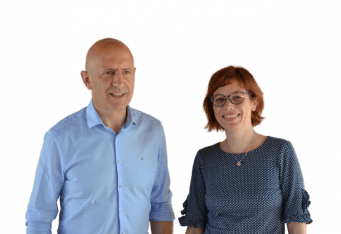 |
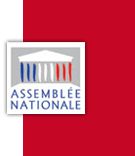 |
 |
 |
 |
 |
Vidéo à la une
Agenda
Lundi 21 avril
Détail de la journéeEn circonscription :
|
| NEWSLETTER Restez informés des actualités de Dominique Potier en vous inscrivant à la newsletter |
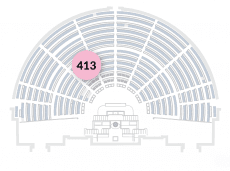
> L'activité de votre député sur le site citoyen NosDéputés.fr
contactPermanence parlementaire
27 avenue du Maréchal Foch
54200 TOUL
Tel : 03 83 64 09 99
Fax : 03 83 64 31 05
Nous écrire
Actualités
« Europe : le déni de soi » par Paul Thibaud

Tribune parue dans Marianne daté du 7 août
Austérité inefficace et crise en Grèce, performances médiocres de l'euro, absence de politique extérieure et repli sur soi face aux migrations… Pour le philosophe Paul Thibaud, l'Institution Europe doit sortir de son narcissisme pour faire son bilan.
L'efficacité de la politique que l'on fait ingurgiter aux Grecs n'est aucunement garantie. Selon Joseph Stiglitz (le Monde du 25 juin), comme selon l'analyse de Marie Charrel – également dans le Monde -, ils ont subi des baisses de dépenses publiques et des baisses de salaire équivalentes à ce qu'ont accepté les « meilleurs élèves » de l'Union. Ce qui les distingue, et les accule, c'est la baisse d'un quart de leur PIB qui s'en est suivie. Au moins dans leur cas, la politique à l'européenne a échoué. Mais la doctrine dit que, si on le prolonge, le traitement ne manquera pas d'être efficace. En fait, il ne s'agit pas d'efficacité, il s'agit qu'ils se mettent en règle. Son formalisme rend l'Europe infalsifiable.
Au premier degré, ce fétichisme des règles tient à l'embrouillamini institutionnel dans l'Union : les compromis décisionnels sont sacralisés parce qu'ils ont été difficiles à obtenir. Comme tout le monde y a mis du sien, ils sont le bien commun, le lien, l'astreinte et le point d'honneur d'une classe politique multinationale. Cette complexité dans un cadre mal défini fait que la décision elle-même importe plus que son contenu. A cette prépondérance de la procédure sur les effets, la classe politique européenne trouve bien des avantages : la rétribution pour avoir abouti est immédiate, alors que les inconvénients sont éventuels et à venir. De plus, ce qu'il y a de sacrificiel dans l'européanisation de l'exercice du pouvoir lui ajoute une aura de moralité.
Formalisme et narcissisme caractérisent une institution dont toute l'énergie est consommée par son fonctionnement. Les problèmes de l'Europe tiennent à sa nature même, mais quelle est cette nature ? Jadis, Jacques Delors a qualifié l'Europe d'« objet politique non identifié ». Cette formule correspondait à une interrogation alors récurrente : fédération ou confédération ? L'étonnant est que le débat que semblait ouvrir Delors n'a jamais eu lieu et qu'on a cessé de se poser la question de l'objet européen. Son absence d'identité est devenue une sorte d'identité.
On a longtemps cru que cette indétermination était provisoire, en attendant, pensaient certains, le passage de l'intergouvernemental à la vraie fédération. Depuis 2005 au moins, on n'espère plus le saut fédéral. On vit dans un entremêlement d'Etats qui se compromettent ensemble dans des politiques qu'ils assument plus ou moins. Ce triomphe de l'immanence sur le projet se traduit par un centrement sur soi, la perte du sens de l'avenir comme celle du sens du monde extérieur. L'Europe n'a pris conscience qu'elle avait un Sud et un Est que lorsque de nouveaux partenaires ont sonné à sa porte. Depuis, elle répète qu'il faut s'adapter, mais l'idée d'anticiper les évolutions du monde ne lui était pas venue.
Après la crise grecque, devant l'échec d'une pratique enfermée dans des règles sommairement uniformes, et mal justifiées, après le choc ressenti quand (encore une fois) s'affiche le mépris de la dignité des peuples, l'Europe devrait chercher un autre type d'entente. Ce serait le moment qu'elle se définisse autrement que comme une habitude ancrée, qu'on la caractérise comme institution, comme projet d'avenir pour le monde. Ce serait le moment, mais il y a peu de chances qu'on le fasse, faute de franchise devant les enjeux, faute en particulier d'une réflexion sur le rapport aux nations qui la constituent. Pour sortir de la situation où elle est encalminée, l'institution Europe devrait affronter les questions qu'elle a jusqu'à présent jugé habile de réserver : faire son bilan, et surtout sortir de la croyance qu'une providence la préserve pour s'interroger sur la dynamique qui la détermine et/ou l'entrave. Encore une fois, sortir de son narcissisme.
De l'euro, certains attendaient des merveilles. Au bout de quinze ans, la performance économique de la zone est particulièrement médiocre. Mais on répète que les « réformes exigées », avec leur effet dépressif, sont nécessaires pour faire entrer dans la mondialisation des pays endormis dans l'Etat de bien-être. Cette apologie rencontre aussitôt un paradoxe et une objection. Le paradoxe, c'est qu'après des décennies vouées à une vaste ambition nous recevions, plus que jamais, la leçon de l'extérieur, au point que l'Europe apparaît souvent comme un relais de la mondialisation. L'objection, c'est que la mise à la raison des peuples par une contrainte externe organisée n'est peut-être pas la meilleure méthode de modernisation, qu'il y a lieu de s'interroger sur ses effets politiques, sociaux et même économiques, surtout s'il s'ensuit une course à l'austérité entre nations.
Non seulement la performance économique de l'Europe est médiocre, mais son absence de politique extérieure est accablante.
Les migrations à travers la Méditerranée font rétrospectivement apparaître scandaleux le long repli sur soi de l'Europe. Mais la critique la plus dévastatrice de notre genre d'union ne concerne pas ses effets, mais sa manière d'être. Le mode européen de gouvernance institue une séparation entre l'exercice du pouvoir et les peuples (séparation que les contempteurs des référendums nationaux avalisent sans état d'âme). C'est là une cause déterminante de la montée des populismes et du discrédit de la politique, de son personnel comme de ses procédures. La crise grecque a même fait apparaître un effet plus pervers d'un système qui implique les peuples en préjugeant de leur consentement, ou en le forçant. Se sont manifestés aussi à cette occasion des préjugés, des prétentions, des rancoeurs, des idées de soi et des autres qui couvaient sous l'uniformisation des règles. Ces particularismes agressifs, la participation à une vie politique commune permet de les surmonter quelque peu dans le cadre national, mais pas dans un simple espace de coréglementation. Il se peut même que la coexistence rapprochée sous un pouvoir éloigné génère de l'hostilité, du chauvinisme, des consciences de supériorité… Le système européen d'interactions subies, sous un pouvoir étranger aux peuples, évoque ce que furent les empires. Ce rapprochement n'a rien d'encourageant. Si Rome a su intégrer les dieux et les élites des peuples soumis, ce n'a pas été le cas des empires modernes. C'est même dans la zone de ces empires (Empire ottoman, Autriche-Hongrie) que les tensions ethniques sont aujourd'hui les plus vives, des peuples privés de participation au pouvoir n'ayant pas pris de distance avec leur fond ethno-religieux.
La crise grecque est un moment de vérité pour la sorte de coopérative de bureaucraties nationales qu'est l'Europe : ni fédérale ni confédérale, mais quasi impériale. Non seulement les Etats voués au grand oeuvre ont dû restreindre leur pouvoir et leurs perspectives, mais les peuples, politiquement externalisés, sont portés à craindre ou à mépriser des voisins proches mais étrangers, avec lesquels ils vivent une sorte de promiscuité. Cet aboutissement est l'effet d'une longue pratique, celle de bâtir l'Europe en contournant le politique. De cette méthode, Jean Monnet a été le premier maître d'oeuvre. Au politique, voué selon lui aux passions irrationnelles, il a opposé le rapprochement et la conciliation des intérêts par les débats entre experts. La logique aurait été le gouvernement de l'Union par la Commission. Cette utopie ne s'est pas réalisée, mais il en est resté une manière d'anticiper les accords sur le fond en créant des situations (l'euro, par exemple) qui doivent obliger les responsables à décider ensemble, donc à resserrer l'unité. En Europe, l'existence, croit-on, détermine non seulement la conscience, mais aussi la volonté.
La carence de politique à quoi renvoient toutes les faiblesses de l'Europe a été clairement désignée par Jürgen Habermas parlant de « dissolution du politique dans la conformité au marché » et du « déficit institutionnel fondamental » révélé par la crise grecque, à savoir le manque « d'une perspective permettant la constitution d'une volonté commune des citoyens » (le Monde du 25 juin). Habermas ne dit pas comment passer du patriotisme national au patriotisme européen, mais il récuse la méthode aujourd'hui à bout de course, la croyance naïve (idéologie ou paresse) que le patriotisme européen ne peut manquer d'apparaître, comme un champignon sur une pelouse, quand les patriotismes nationaux auront été suffisamment rabaissés et intriqués. On oublie ainsi qu'inventer un sujet politique, c'est inventer un acteur, donc qu'il y faut un geste positif, une vue de l'avenir, une anticipation, non une conformation. Une flagrante contradiction afflige la pensée européenne standard, celle de croire qu'une grande création politique peut passer par un point bas, voire un point zéro, de la politique, en l'occurrence par un congé désinvolte donné à la nation, donc à ce qui est sans doute la principale invention de l'Europe.
Le narcissisme de l'institution européenne, sa difficulté à ne se rapporter à aucun extérieur, donc à aucun projet, apparaîtra excusable à qui considère que l'Europe instituée vaut par ce qu'elle est supposée remplacer, les nations européennes. Considérée dans une perspective longue, cette impatience à sortir de l'époque des nations est absurde. L'Europe des nations (ce petit bout de continent) a vu pendant des siècles naître et s'affirmer cinq ou six grandes cultures, échangeant et s'affrontant. Mais, de cet exploit sans équivalent, de cette variété productive, c'est à peine si les Européens actuels sont conscients, les catastrophes du XXe siècle les ayant séparés de ce grand passé. En tout cas, au sortir du XXe siècle, ils ne se sont pas sentis capables de bâtir un nouvel équilibre entre la diversité créatrice et l'exigence universaliste. Par faiblesse spirituelle, ils se sont enfermés dans la négativité. Au lieu de vouloir, ils ont préféré se délester ; ils se sont voués à une sorte de pragmatisme négatif, rongeur de ce à quoi, le sachant ou non, ils tenaient, pragmatisme qu'ils ont associé à un idéalisme tout aussi négatif, souvent pénitentialiste. Ils ont pensé faire leur salut en se déniant. Le choix de cette voie, de cette sortie par le bas, révèle un fond de lassitude, voire une détestation de soi, une soif de se désavouer qu'il reste à comprendre, et à surmonter.
Historien et philosophe, ancien directeur de la revue Esprit.
L'efficacité de la politique que l'on fait ingurgiter aux Grecs n'est aucunement garantie. Selon Joseph Stiglitz (le Monde du 25 juin), comme selon l'analyse de Marie Charrel – également dans le Monde -, ils ont subi des baisses de dépenses publiques et des baisses de salaire équivalentes à ce qu'ont accepté les « meilleurs élèves » de l'Union. Ce qui les distingue, et les accule, c'est la baisse d'un quart de leur PIB qui s'en est suivie. Au moins dans leur cas, la politique à l'européenne a échoué. Mais la doctrine dit que, si on le prolonge, le traitement ne manquera pas d'être efficace. En fait, il ne s'agit pas d'efficacité, il s'agit qu'ils se mettent en règle. Son formalisme rend l'Europe infalsifiable.
Au premier degré, ce fétichisme des règles tient à l'embrouillamini institutionnel dans l'Union : les compromis décisionnels sont sacralisés parce qu'ils ont été difficiles à obtenir. Comme tout le monde y a mis du sien, ils sont le bien commun, le lien, l'astreinte et le point d'honneur d'une classe politique multinationale. Cette complexité dans un cadre mal défini fait que la décision elle-même importe plus que son contenu. A cette prépondérance de la procédure sur les effets, la classe politique européenne trouve bien des avantages : la rétribution pour avoir abouti est immédiate, alors que les inconvénients sont éventuels et à venir. De plus, ce qu'il y a de sacrificiel dans l'européanisation de l'exercice du pouvoir lui ajoute une aura de moralité.
Formalisme et narcissisme caractérisent une institution dont toute l'énergie est consommée par son fonctionnement. Les problèmes de l'Europe tiennent à sa nature même, mais quelle est cette nature ? Jadis, Jacques Delors a qualifié l'Europe d'« objet politique non identifié ». Cette formule correspondait à une interrogation alors récurrente : fédération ou confédération ? L'étonnant est que le débat que semblait ouvrir Delors n'a jamais eu lieu et qu'on a cessé de se poser la question de l'objet européen. Son absence d'identité est devenue une sorte d'identité.
On a longtemps cru que cette indétermination était provisoire, en attendant, pensaient certains, le passage de l'intergouvernemental à la vraie fédération. Depuis 2005 au moins, on n'espère plus le saut fédéral. On vit dans un entremêlement d'Etats qui se compromettent ensemble dans des politiques qu'ils assument plus ou moins. Ce triomphe de l'immanence sur le projet se traduit par un centrement sur soi, la perte du sens de l'avenir comme celle du sens du monde extérieur. L'Europe n'a pris conscience qu'elle avait un Sud et un Est que lorsque de nouveaux partenaires ont sonné à sa porte. Depuis, elle répète qu'il faut s'adapter, mais l'idée d'anticiper les évolutions du monde ne lui était pas venue.
Après la crise grecque, devant l'échec d'une pratique enfermée dans des règles sommairement uniformes, et mal justifiées, après le choc ressenti quand (encore une fois) s'affiche le mépris de la dignité des peuples, l'Europe devrait chercher un autre type d'entente. Ce serait le moment qu'elle se définisse autrement que comme une habitude ancrée, qu'on la caractérise comme institution, comme projet d'avenir pour le monde. Ce serait le moment, mais il y a peu de chances qu'on le fasse, faute de franchise devant les enjeux, faute en particulier d'une réflexion sur le rapport aux nations qui la constituent. Pour sortir de la situation où elle est encalminée, l'institution Europe devrait affronter les questions qu'elle a jusqu'à présent jugé habile de réserver : faire son bilan, et surtout sortir de la croyance qu'une providence la préserve pour s'interroger sur la dynamique qui la détermine et/ou l'entrave. Encore une fois, sortir de son narcissisme.
De l'euro, certains attendaient des merveilles. Au bout de quinze ans, la performance économique de la zone est particulièrement médiocre. Mais on répète que les « réformes exigées », avec leur effet dépressif, sont nécessaires pour faire entrer dans la mondialisation des pays endormis dans l'Etat de bien-être. Cette apologie rencontre aussitôt un paradoxe et une objection. Le paradoxe, c'est qu'après des décennies vouées à une vaste ambition nous recevions, plus que jamais, la leçon de l'extérieur, au point que l'Europe apparaît souvent comme un relais de la mondialisation. L'objection, c'est que la mise à la raison des peuples par une contrainte externe organisée n'est peut-être pas la meilleure méthode de modernisation, qu'il y a lieu de s'interroger sur ses effets politiques, sociaux et même économiques, surtout s'il s'ensuit une course à l'austérité entre nations.
Non seulement la performance économique de l'Europe est médiocre, mais son absence de politique extérieure est accablante.
Les migrations à travers la Méditerranée font rétrospectivement apparaître scandaleux le long repli sur soi de l'Europe. Mais la critique la plus dévastatrice de notre genre d'union ne concerne pas ses effets, mais sa manière d'être. Le mode européen de gouvernance institue une séparation entre l'exercice du pouvoir et les peuples (séparation que les contempteurs des référendums nationaux avalisent sans état d'âme). C'est là une cause déterminante de la montée des populismes et du discrédit de la politique, de son personnel comme de ses procédures. La crise grecque a même fait apparaître un effet plus pervers d'un système qui implique les peuples en préjugeant de leur consentement, ou en le forçant. Se sont manifestés aussi à cette occasion des préjugés, des prétentions, des rancoeurs, des idées de soi et des autres qui couvaient sous l'uniformisation des règles. Ces particularismes agressifs, la participation à une vie politique commune permet de les surmonter quelque peu dans le cadre national, mais pas dans un simple espace de coréglementation. Il se peut même que la coexistence rapprochée sous un pouvoir éloigné génère de l'hostilité, du chauvinisme, des consciences de supériorité… Le système européen d'interactions subies, sous un pouvoir étranger aux peuples, évoque ce que furent les empires. Ce rapprochement n'a rien d'encourageant. Si Rome a su intégrer les dieux et les élites des peuples soumis, ce n'a pas été le cas des empires modernes. C'est même dans la zone de ces empires (Empire ottoman, Autriche-Hongrie) que les tensions ethniques sont aujourd'hui les plus vives, des peuples privés de participation au pouvoir n'ayant pas pris de distance avec leur fond ethno-religieux.
La crise grecque est un moment de vérité pour la sorte de coopérative de bureaucraties nationales qu'est l'Europe : ni fédérale ni confédérale, mais quasi impériale. Non seulement les Etats voués au grand oeuvre ont dû restreindre leur pouvoir et leurs perspectives, mais les peuples, politiquement externalisés, sont portés à craindre ou à mépriser des voisins proches mais étrangers, avec lesquels ils vivent une sorte de promiscuité. Cet aboutissement est l'effet d'une longue pratique, celle de bâtir l'Europe en contournant le politique. De cette méthode, Jean Monnet a été le premier maître d'oeuvre. Au politique, voué selon lui aux passions irrationnelles, il a opposé le rapprochement et la conciliation des intérêts par les débats entre experts. La logique aurait été le gouvernement de l'Union par la Commission. Cette utopie ne s'est pas réalisée, mais il en est resté une manière d'anticiper les accords sur le fond en créant des situations (l'euro, par exemple) qui doivent obliger les responsables à décider ensemble, donc à resserrer l'unité. En Europe, l'existence, croit-on, détermine non seulement la conscience, mais aussi la volonté.
La carence de politique à quoi renvoient toutes les faiblesses de l'Europe a été clairement désignée par Jürgen Habermas parlant de « dissolution du politique dans la conformité au marché » et du « déficit institutionnel fondamental » révélé par la crise grecque, à savoir le manque « d'une perspective permettant la constitution d'une volonté commune des citoyens » (le Monde du 25 juin). Habermas ne dit pas comment passer du patriotisme national au patriotisme européen, mais il récuse la méthode aujourd'hui à bout de course, la croyance naïve (idéologie ou paresse) que le patriotisme européen ne peut manquer d'apparaître, comme un champignon sur une pelouse, quand les patriotismes nationaux auront été suffisamment rabaissés et intriqués. On oublie ainsi qu'inventer un sujet politique, c'est inventer un acteur, donc qu'il y faut un geste positif, une vue de l'avenir, une anticipation, non une conformation. Une flagrante contradiction afflige la pensée européenne standard, celle de croire qu'une grande création politique peut passer par un point bas, voire un point zéro, de la politique, en l'occurrence par un congé désinvolte donné à la nation, donc à ce qui est sans doute la principale invention de l'Europe.
Le narcissisme de l'institution européenne, sa difficulté à ne se rapporter à aucun extérieur, donc à aucun projet, apparaîtra excusable à qui considère que l'Europe instituée vaut par ce qu'elle est supposée remplacer, les nations européennes. Considérée dans une perspective longue, cette impatience à sortir de l'époque des nations est absurde. L'Europe des nations (ce petit bout de continent) a vu pendant des siècles naître et s'affirmer cinq ou six grandes cultures, échangeant et s'affrontant. Mais, de cet exploit sans équivalent, de cette variété productive, c'est à peine si les Européens actuels sont conscients, les catastrophes du XXe siècle les ayant séparés de ce grand passé. En tout cas, au sortir du XXe siècle, ils ne se sont pas sentis capables de bâtir un nouvel équilibre entre la diversité créatrice et l'exigence universaliste. Par faiblesse spirituelle, ils se sont enfermés dans la négativité. Au lieu de vouloir, ils ont préféré se délester ; ils se sont voués à une sorte de pragmatisme négatif, rongeur de ce à quoi, le sachant ou non, ils tenaient, pragmatisme qu'ils ont associé à un idéalisme tout aussi négatif, souvent pénitentialiste. Ils ont pensé faire leur salut en se déniant. Le choix de cette voie, de cette sortie par le bas, révèle un fond de lassitude, voire une détestation de soi, une soif de se désavouer qu'il reste à comprendre, et à surmonter.

